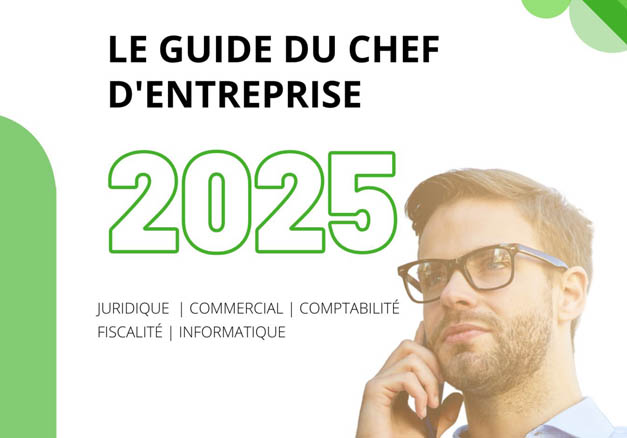Les associations et les fondations qui font partie d’un même groupement ou qui entretiennent des relations étroites peuvent plus facilement se consentir des prêts ou mettre en place des opérations de trésorerie.
Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !
Quels sont les organismes concernés ?
Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :
– des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;
– des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;
– des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;
– des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;
– les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;
– des lieux de vie et d’accueil.
Des opérations de prêts
Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :
– un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
– un groupement d’intérêt économique ;
– un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;
– un groupement de coopération sanitaire de moyens ;
– une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;
– un groupement d’employeurs ;
– une union d’économie sociale ;
– une union d’association ;
– un groupement constitué volontairement. Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :
– la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
– la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
– une gouvernance en tout ou partie commune ;
– l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.
Important : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.
Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur. Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en lien avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.
À savoir : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.
Des opérations de trésorerie
En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :
– qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;
– ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).
À noter : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025).
Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.
Décret n° 2025-779 du 7 août 2025, JO du 8Décret n° 2025-780 du 7 août 2025, JO du 8
Article publié le 12 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR