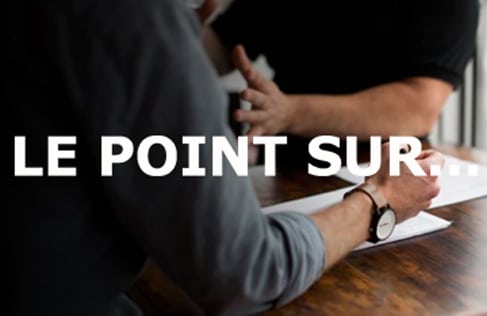Le point sur les règles à respecter pour gérer le jour férié du 14 juillet dans votre entreprise qui, cette année, tombe un dimanche.
Hormis le 1er mai qui fait l’objet de règles particulières, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler durant les jours fériés dits « ordinaires », et notamment le 14 juillet. À moins qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective s’y oppose.
Exception : en principe, les jours fériés ordinaires sont obligatoirement des jours chômés pour les jeunes de moins de 18 ans et pour les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Mais attention, car cette année, le 14 juillet tombe un dimanche ! Aussi, seuls les employeurs qui disposent d’une dérogation au repos dominical pourront faire travailler leurs salariés ce jour-là. Si c’est votre cas, vérifiez votre convention collective qui peut allouer une majoration de salaire au profit des salariés qui travaillent un jour férié. En outre, elle peut aussi prévoir une majoration en cas de travail le dimanche. Sachant qu’en principe, ces deux majorations ne se cumulent pas lorsque le jour travaillé tombe un dimanche.
Rappel : les employeurs autorisés à déroger au repos dominical en raison de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris doivent accorder, aux salariés concernés, une rémunération au moins égale au double de celle qui leur est normalement due pour une durée de travail équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
Enfin, sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Article publié le 24 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot